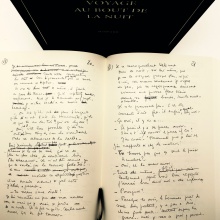À la une du journal La Croix de ce matin[1], on a rédigé un article de fond sur l’École nationale d’administration (l’ENA). On y lit en gras « Faut-il supprimer l’ENA ? » Mine de rien, j’ai été quelque peu surpris d’apprendre qu’on puisse même envisager la possibilité de supprimer l’école qui a essentiellement formé la nomenklatura française, y compris plusieurs présidents de la République française, comme si on supprimait un train retardé dans une gare de banlieue parisienne. En effet, la question qui s’en dégage, c’est de savoir si l’ENA a pris du retard par rapport à notre époque, celle qui est marquée par de nouveaux enjeux inédits : terrorisme djihadiste, crise migratoire, crise économique, crise de l’Union européenne, et j’en passe – si bien qu’il faut la supprimer ? Globalement parlant, faut-il remanier la fonction publique française ?
Créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en octobre 1945 par le général de Gaulle, l’École nationale d’administration avait pour but initial de former un corps de grands serviteurs de l’Etat à qui était confiée la tâche de reconstruire la République. Sa mission était donc principalement de former la haute fonction publique – les serviteurs du bien commun.
Soixante-dix ans après, la face de l’École du pouvoir a bien changé. Loin de son début assuré comme école formatrice de hauts fonctionnaires, « ce qui pose sans doute le plus problème aujourd’hui avec le système ENA est la connivence qu’il crée entre l’administration, le monde politique et les grandes entreprises. » En effet, les statistiques de l’École des hautes études en sciences sociales publiées en 2015 montrent qu’au cours des trente dernières années, moins de 5% des énarques assurent un poste de responsabilité politique. En comparaison, 22% travaillent pour le monde de l’entreprise ; et 8% ont définitivement quitté la fonction publique.[2] En revanche, présenter ces chiffres les uns à côté des autres est un trompe-l’œil, car on n’a qu’à en déduire que la variété des débouchés chez les énarques a augmenté. Or, les réseaux qui se tissent entre les futurs hommes politiques, ministres, chefs d’entreprise formés à l’ENA sont la réalisation d’une certaine idée du capitalisme de connivence, c’est-à-dire un modèle social dans lequel l’élite au pouvoir se serre les coudes en servant les intérêts des uns et des autres.
En un temps où la grande finance a pris le dessus en reléguant au second plan le pouvoir de l’Etat, cette tendance des énarques de se réorienter vers le secteur privé constitue-t-elle une dérive par rapport à la mission de départ ? Ou bien, L’Ecole ne fait qu’évoluer tant bien que mal au gré des changements socioéconomiques auquel cas il serait infondé de dire que l’Ecole a pris du retard ? Et puis, faut-il aller jusqu’à supprimer l’ENA, cette école qui représente un héritage précieux, cet esprit de service de la collectivité qui manque dans bien d’autres pays[3] ?
Si l’ENA a évolué au gré de grands changements socioéconomiques, la réputation de l’école a pris des proportions surdimensionnées. Pour beaucoup de jeunes gens issus des milieux privilégiés dont les parents sont eux-mêmes hauts fonctionnaires, intégrer l’ENA est souvent perçue comme la voie royale pour accéder à la prestige sociale. Il n’est donc pas surprenant de constater que 75% des effectifs du cycle de formation initiale sont des élèves français[4].
Les conséquences d’une démographie étudiante pour la plupart homogène peuvent être à l’origine d’une stagnation sociale et politique en France. Dans son rapport des concours de l’année 2015, Jean-Paul Faugère, énarque et ancien directeur de cabinet de François Fillon à Matignon, a commenté l’épreuve dite de « question contemporaine », qui offre aux candidats l’opportunité de développer l’idée qu’ils se font du « sens de l’Etat ». Un sujet que l’on imagine particulièrement concernant lorsqu’on se destine à diriger les plus hautes instances de l’administration publique. Or « les résultats observés ne sont pas entièrement convaincants, commente le rapport. Le conformisme répétitif de certaines copies pouvant décevoir.[5] »
À cette question de formatage d’élèves s’ajoute celle du classement de sortie. Un sur dix élèves, soit le meilleur dix pour cent de la promotion, intègre à sa sortie les grands corps de l’Etat. Autrement dit, la possibilité d’intégrer la haute fonction publique et par conséquent la qualité de nos élus repose sur des bonnes notes, non sur une expérience professionnelle approfondie.
Serait-il donc légitime de dire que le manque de dynamisme politique français auquel nous faisons face aujourd’hui peut être attribué à l’influence que l’ENA exerce sur le gouvernement ? Conformisme intellectuel, élitisme, connivence…autant de mots qui semblent décrire non seulement les élèves de cette école, mais encore l’état actuel de la politique en France.
Mais il faut aussi se rendre à l’évidence. La haute fonction publique est la voie royale pour beaucoup de Français et Françaises. En faisant le bilan des autres pays comme les États-Unis, par exemple, force est de constater que la plupart de gens finissent par travailler dans le secteur privé. La crise de la dette étudiante aux Etats-Unis, n’est qu’une des raisons pour lesquelles les Américains, afin de s’acquitter de leurs dettes, se voient obligés de viser un emploi à forte rémunération. Autant de raisons pour se dire que la France s’en sort mieux – car il faut à tout prix continuer à encourager les gens à servir le bien commun quitte à partir à la dérive de temps en temps. Tant que l’esprit de service de la collectivité qu’incarne l’ENA reste intact, il ne faudra pas supprimer l’ENA. Autant dire que la tradition peut aussi inspirer de grands changements.
♣♣♣
— C.S.
[1] Goubert, Guillaume. « Faut-il supprimer l’ENA ? » La Croix. [Paris, France] vendredi 2 septembre 2016 : pp.1-3. Print.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] http://www.ena.fr/L-ENA-se-presente/ressources-ena/ena-chiffres
[5] http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/03/14/l-ena-ne-veut-pas-d-eleves-formates_4882572_4401467.html