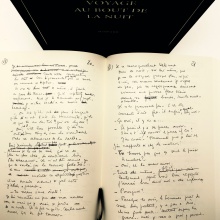Chapitre II
Le jardin qui meurt
« Ce qui m’embête au plus haut point, c’est qu’on prétend vouloir la vraie démocratie tandis qu’on met la pression au gouvernement pour qu’il démissionne avant les élections. Et n’oublions pas qu’ils ont déjà réussi à dissoudre le parlement rien que pour faire plaisir à près d’un million d’individus sur les autres quarante-huit millions d’individus qui leur opposent. Si c’est bien ça la vraie démocratie, alors ça se saurait ! Il est vrai que ce gouvernement n’est pas le meilleur qui n’ait jamais régné sur Terre, j’avoue, mais il est certains procédés qu’il faut suivre quoi qu’il en soit. Soutenir pour que ce gouvernement reste en place n’est peut-être pas la meilleure ligne de conduite à tenir, mais c’est sans doute la bonne chose à faire. Si le peuple n’est toujours pas content au bout du mandat, ils auront droit à la réélection. Tiens ! Toi qui habites en France, tu sais bien qu’il y a pas mal de gens qui se plaignent des failles dans le système politique français, mais du moins chacun a la sagesse de respecter les droits démocratiques pour lesquels on a tant lutté. Moi je vous le dis, il y a encore du travail à faire avant que la Thaïlande ne devienne un véritable pays démocratique. Je ne puis qu’espérer voir le jour où cela se produira. »
Sur ce, elle termine son discours. Nous autres, nous étions restés assis à regarder sa bouche débiter ces mots inutiles. Pour ma part, je m’en fiche un peu de l’avenir de notre pays. Depuis qu’on m’a envoyé étudier dans une école internationale, et qu’étant ensuite parti faire mes études supérieures en France, tout lien qui me rattachait à ma patrie s’est déchiqueté une bonne fois pour toutes. Mais là-bas, on me prenait pour un étranger asiatique qui ne s’intégrerait jamais à la France ni à ses mœurs. Il n’y a plus de doute. Je suis un jeune homme d’entre deux mondes qui n’en appartient à aucun des deux. Tout à coup, ma mère reprend :
- Au fait, ton ami, Monsieur Jacquet, il m’a appelé l’autre jour pour prendre de tes nouvelles. C’est très gentil de sa part, tu sais, de se faire autant de soucis à ton propos, tandis que quasiment tous tes amis là-bas t’ont oublié. Mais bon, comment veux-tu qu’on essaie de rester en contact avec toi si c’est toi qui as coupé le pont avec eux le premier ?
- C’est vrai ? Il est bien gentil celui-là, dis-je en ignorant la morale qu’elle vient de me faire. Je lui écrirai un mail. Seulement, grand-maman n’a pas de réseau Internet ici.
- Alors, rentre avec moi. Tu me manques beaucoup là-bas. La maison est si vide sans toi chaque soir quand je rentre du bureau.
- Non, pas encore. J’ai besoin d’être seul. De toute façon, je lui enverrai une lettre. Je sais que ça ne se fait plus de nos jours, mais bon…
- Comme tu veux. Mais je te signale qu’en restant ici où personne ne peut te joindre, enfermé dans ton petit monde, tu risques de partir à la dérive. Sois sage et écoute-moi bien : on peut toujours remédier à ta situation. Ce n’est pas trop tard.
Mais je ne l’écoute plus. Je pense à Monsieur Jacquet. Je fis sa connaissance lors de la première année de mes études, alors que j’étais logé en famille d’accueil dans la banlieue parisienne d’Argenteuil, dont il était le voisin d’en face. Cet homme français, âgé de soixante-dix ans environ, aux cheveux poivre et sel, dont les yeux bleu marin percent jusqu’aux profondeurs de l’âme, est l’homme le plus intelligent que je connaisse. Tout le monde, même ses proches, l’appelle ainsi par respect de son intellect foudroyant. Il n’est donc pas étonnant que ce monsieur fasse partie de mon récit. De fait, je me suis toujours plaisanté de le nommer « Mr. Jacket » si jamais un jour l’occasion me venait d’écrire sur lui. Mais aujourd’hui, au moment de son introduction dans le tissage, je ne vois plus aucune raison justifiant ce drôle de nom sauf celle d’accorder un surnom à un ami pour qui j’ai beaucoup d’estime et d’affection. Depuis quelque temps, je le vois comme le père que je n’ai jamais eu. J’en ai un, bien entendu. C’est celui qui a fait sa part de la besogne afin de permettre mon existence. Mais ce n’est pas mon père. Monsieur Jacquet a toujours veillé sur moi. Lorsque j’étais gravement enrhumé, il traversait la rue pour me rendre visite, m’apportant du potage chaud et des conseils de santé. Lorsque je me déprimais, il me disait d’ouvrir grand la fenêtre de ma chambre, car « un peu de soleil aide toujours à monter le moral ». Et voilà qu’à présent, il prend de mes nouvelles de loin. De plus, Monsieur Jacquet est un savant, incroyablement instruit dans tous les domaines de la connaissance humaine. Étant à ce point érudit, il convient qu’une telle personne se sente obligé de faire rayonner sa brillance sur les autres. Alors il parle. Il aime parler, ce Monsieur Jacquet. Son seul défaut : il n’écoute personne.
Alors, voyant que je deviens taciturne, maman arrête de parler du politique. Tout au long de cette conversation anodine dont elle s’est exclue, grand-mère avait le regard fixé à travers la porte vitrée du salon qui donne sur le jardin. À présent, elle le regarde toujours de ses yeux au bord des larmes. Chacun ne fait plus le moindre bruit, comme lorsqu’on se rend compte tardivement de quelque chose ou quelqu’un qui ne va pas.
- Qu’est-ce qui ne va pas, maman ? s’enquête ma mère.
- Le jardin meurt.
- Hein ?
- Le jardin meurt. Il était si beau avant. Maintenant c’est un désert. J’habite seul ici, et tous les jours je fais tout pour qu’il revienne à la vie. Engrais de la meilleure qualité, système d’arrosage haut de gamme, j’ai même fait venir un horticulteur célèbre. Rien n’y fait : mes plantes continuent à mourir.
- Mais ça alors ! Et moi qui étais tellement inquiète. Maman, ce n’est qu’un jardin…Pourquoi perds-tu tant de sommeil dessus ? Il meurt, c’est vrai. Mais il reviendra, je te l’assure.
- Je crois que non. Et si je perds autant de sommeil là-dessus, c’est parce que mon jardin est la seule chose à laquelle je tienne toujours de cette vie. Ce n’est pas pour vous faire de la peine, croyez-moi. Seulement, je préfère parler franchement, surtout à ce stade dans la vie.
Personne ne dit plus rien. Au bout d’un moment, grand-mère se lève et, passant à travers la porte vitrée, elle descend à pas lents au jardin. Moi et maman, nous sommes restés à la regarder faire ce chemin, qui était bordé de plantes d’un vert délavé. En dehors du vert, les quelques rares fleurs éparses parsemaient le peu de couleurs vives ; ici et là, des touffes d’herbe qui recouvrent à peine la terre rouge, comme un tapis qui avait été rongé par les mites ; par contre, là où je suis parti en balade, les montagnes sont somptueusement vertes. Surplombant le terrain en contrebas, elles semblent vouloir en rajouter à ce jardin moribond. Grand-mère continue à s’éloigner de nous, comme un bateau égaré au milieu de l’océan qui vogue au gré du vent. Puis, s’arrêtant devant la souche d’un banian maladif, elle se met à pleurer, le dos tourné, défaillante.
À l’exception de quelques massifs d’héliconies et d’orchidées suspendues, le jardin meurt effectivement. On n’a jamais su pourquoi. Tout ce qu’on sait, c’est que son état moribond a commencé en même temps que celui de grand-père. Suite à une attaque d’apoplexie à l’âge de quatre-vingt-deux ans, celui-ci ne pouvait plus parler ni faire bouger aucun membre de son corps. Il était désormais alité et nécessitait qu’on enfonce aux tréfonds de sa gorge un gros tube de respiration qui induisait des vomissements effrénés. Quand grand-père vomissait, c’était le seul moment où tout son corps atrophié semblait tressaillir bien malgré lui. Et on sentait alors que son âme devenait un peu plus souillée encore qu’auparavant. En vérité, ce tube était le dernier lien qui le gardait en vie. Il prenait aussi des médicaments qui donnent la nausée perpétuelle, tout cela parce qu’on espérait voir son état s’améliorer, alors qu’en réalité on ne faisait que prolonger sa souffrance ; on se voilait la face parce qu’on l’aimait. Il vivait ainsi pendant près de deux ans, dans cette vieille coque décrépite, pourrie jusqu’au trognon de son âme, sans dignité. Dans le salon aménagé en infirmerie, le lit placé devant la porte vitrée, et, regardant le jardin moribond dans la fraîcheur du petit matin, grand-père mourut le 25 janvier 2011, le lendemain de mon anniversaire.
J’ai pensé à tout cela en un instant, avant de rattraper maman qui était partie à toute allure consoler grand-mère. Celle-ci pleure toujours devant cette métaphore brutale de sa vie qui ne tardera pas à pourrir, à périr.
Dans un soudain élan de tristesse, j’oublie mes chagrins, mon désespoir, et cette indifférence envers la vie qui m’habitait, et qui me rongeait l’âme, jusque-là. J’oublie mon égoïsme, mon orgueil et ma vanité. J’oublie tout ce qui ne compte pas, ou plutôt, tout ce qui ne vaut plus la peine d’être compté. J’oublie la frivolité, la petitesse de mon existence, et ses moments de mélodrame. Une boule monte dans ma gorge. C’est le même dégoût que j’éprouvais à table parmi les petites madeleines et macarons, quelques jours plus tôt. C’est la haine violente contre tout l’excès dans ma vie qui m’habite désormais, qui m’étouffe ; et, bouleversé, étourdi, confus, une envie irrésistible prend le dessus. C’est cette envie de raser d’un coup de lame les fioritures de la vie, de me débarrasser de toutes ces choses qui me salissent, comme on se cure les ongles qui puent. Non ! Ce ne sera pas tout dire ! C’est une envie de me donner la mort. Non ! Même pas ! Je veux m’effacer de ce monde ! De cette existence lamentable ! Je veux ne jamais avoir existé !
En même temps que cette haine, j’éprouve également un amour pour grand-mère que je ne savais jamais avoir eu en moi. Avant, j’avais de la pitié pour elle. Seulement, je croyais à tort en avoir, car c’était, en vérité, de la pitié pour soi que j’avais. Débarrassé, épuré à tout jamais de ce venin qui m’aigrissait, et qui me viciait le sang, je peux finalement l’aimer. Alors, de mes deux bras grands ouverts, et les joues pressées contre ses cheveux, je la serre fort. Je serre son petit corps chétif tremblant. Je lui dis combien je suis désolé de l’avoir traité en vieux traîne-misère. Je lui dis que tout ira mieux. Pour la première fois, je lui dis que je l’aime.
–C.S.