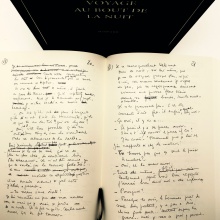Chapitre III
Entre la vie et la mort
Au mois d’avril de chaque année, toute la famille se réunit à Hua Hin, autrefois un petit village de pêcheurs devenu de nos jours une station balnéaire fréquentée par la bourgeoisie thaïlandaise. Dans les années 1920, le roi décide d’y faire bâtir son palais au bord de la mer, qu’il nomme Wang Klai Kangwon ; « loin des soucis ». Ironie du sort, car c’était ici que quelque chose viendrait me chambouler la vie, me faisant poser ces questions qui me lassent aujourd’hui.
C’est au mois d’avril de chaque année que toute la famille se réunit pour la fête de Qing Ming. Il faut noter que la famille du côté de ma mère n’est pas d’origine chinoise. Mais on raconte que arrière-grand-père était un vrai excentrique qui était féru de la culture de ce pays. Il fit construire alors une demeure à flanc de coteau où il passait son temps à boire du thé. Quant à sa femme, elle résidait dans une demeure au bord de la mer à plusieurs kilomètres de là, où grand-père aurait plus tard l’idée géniale d’envoyer à grand-mère le sable de ces plages. Arrière-grand-père prenait goût à cet endroit, à tel point qu’il décida, un beau jour, de faire construire dans le même terrain un mausolée où ses cendres et celles de sa femme reposeraient. Malgré les avertissements des gens d’alentour contre le malheur que ferait porter la construction précoce d’un mausolée, il poursuivit ses projets. Une fois achevé en 1938, il mourut. Son dernier souhait fut que toute la famille, c’est-à-dire celle de grand-père, de son grand frère et de sa grande sœur, s’y réunisse chaque année à tout prix, une façon de se montrer solidaire malgré le passage du temps et les disputes autour de l’héritage devenu de plus en plus difficile à faire partager. Depuis lors, c’est devenu une sorte d’obligation familiale plutôt qu’une tradition chérie.
En avril 2008, il s’est passé quelque chose qui contribuerait à cette crise de jeunesse, si vous voulez, que je vis actuellement. Comme à chaque ouverture annuelle du mausolée, on arrivait dans une voiture de luxe neuve, ou parfois c’était un collier de perles autour d’un cou flasque et indigne. Pour les hommes, ils s’étaient offerts des montres suisses qui coûtent encore plus cher que leurs voitures de luxe ; autant d’efforts pour se montrer plus riches, plus heureux, que tous les autres. Cette fois, comme les fois précédentes, tout s’est passé avec les mêmes bavardages abrutissants, toujours ces rattrapages anodins et prévisibles à propos de combien la vie est belle, toujours gardant les apparences figées en cire, n’osant jamais déraper, se hasarder à montrer leurs faiblesses cachottières pour une fois. La réunion terminée, nous repartions chacun de son côté. Ce serait encore la même chose l’année suivante.
Nous quittâmes le mausolée en voiture. Ma tante était au volant, grand-père assis à côté, grand-mère, maman et moi, nous étions assis en arrière. Au pied de la colline, une voie ferrée longeait un terrain de terre battue. Derrière chaque côté des rails, de très grands buissons obscurcissaient la vue d’un train qui arrivait en douceur, ceux-ci absorbant également les bruits de son approche. Alors, ma tante conduisait en aveugle, et à l’endroit où il devait y avoir une barrière pour nous empêcher de traverser à cet instant, de mourir sur place, il n’y avait rien. Ma tante s’apprêtait à traverser la voie, personne ne sachant que le temps de gagner les cinq mètres qui nous séparaient de l’autre côté de la voie, cet autre côté qui nous tendait un piège, nous serions déjà tous morts. Le pied légèrement appuyé sur la pédale, la voiture s’avança, nous marchions tous vers la mort.
Tel un mauvais pressentiment qui nous frappe comme un éclair, ma tante freina subitement. Et le train coupa droit devant nous, à quelques centimètres de la carrosserie. Nous étions au seuil de la mort, mais nous avons manqué de sonner. Et ce train qui nous aurait pris avec lui, ce train de la mort, à présent il s’éloignait de nous, alors que nous, nous n’avions pas bougé de nos sièges. Nous étions stupéfaits, obnubilés, incrédules. Nous avions triché la mort. Nous étions changés à tout jamais.
[…]
Maman est repartie à Bangkok depuis trois jours. À l’instigation de celle-ci, grand-mère et moi-même sommes partis hier, à notre tour, séjourner à la maison de Hua Hin au bord de la mer. Elle a raison : nous avons besoin d’un changement de paysage. Depuis quelques jours, le jardin de la maison de campagne l’obsède. Elle ne le quittait plus des yeux quand elle n’était pas en train de manier difficilement une pelle aussi grande qu’elle. Elle était malade. Quoiqu’inavoué, moi aussi j’avais besoin d’un changement de paysage. Au début, l’isolation qu’offre le calme des montagnes me semblait précisément ce dont j’avais besoin. Après, elle était devenue insupportable. D’ailleurs, je commençais à avoir des idées suicidaires. Il était bien temps que nous partions.
Malgré les grands vents de la mer, il fait moins frais ici. Dans la journée, la grande marée avale la plage. Le va-et-vient des vagues, montant, brisant, postillonnant des jetées d’eau, écumant le rivage submergé, puis retournant à la mer en nappes claires, comme un tapis d’eau traîné vers l’abîme. La nuit, l’eau redescend et la plage s’ouvre grand à la joie des promeneurs du soir. En arrière-fond, on entend toujours de loin les bruissements berceurs des vagues sous le croissant de lune.
C’est le réveillon du nouvel an. Il est onze heures du soir. Je me promène sur la plage. Partout, la fête s’organise. En entendant la clameur de la foule de fêtards, je me réjouis. Il y a longtemps que je me suis enfermé dans mon petit monde, pensif et, par conséquent, déprimé. Ce soir sera la première fois depuis très longtemps que je fais des vœux, des vrais. J’ai envie d’en finir avec toutes ces choses qui me chagrinent, de tourner la page sans avoir pour autant tout lu.
Tout autour de moi, les gens commencent à faire voler des lanternes célestes, faites de papier de riz de différentes couleurs. Minuit arrive, sur le fond noir du ciel peuplé de petites tâches lumineuses rouge, bleue, violet, vert, blanc, et d’autres couleurs. Mais j’ai le regard baissé par terre. Avec ma lampe de poche, je parcours la terre jonché de petits trous de crabe et de boules de sable avec, par endroits, de gros trous. À chaque pas en avant, ces corps minuscules de la même couleur grise du sable, uniquement perceptibles grâce à leur mouvement rapide, se manœuvrent en sorte d’éviter de se faire écraser sous mes pieds. De temps à autre, j’en aperçois un gros s’empressant de rentrer dans son trou. Alors, me prêtant à un jeu d’enfants, accroupi par terre, le faisceau dirigé à l’intérieur d’un gros trou quelconque, j’espère énerver le gros crabe pour le faire sortir. Il ne sort pas. Il m’énerve, ce crabe. Juste au moment où je m’apprête à me fourrer un doigt dedans, une voix de femme s’élève derrière moi :
« C’est donc ça ce qu’on fait pour fêter le réveillon ? »
Je me tourne vers la voix, en dirigeant le faisceau de la lampe vers elle. De toutes les choses qui me frappent à première vue, c’est le rouge vif de ses lèvres, suivi de sa robe de plage, rouge vif aussi. Elle est coiffée en toupet, les cheveux marrons, sûrement teints, qui descendent jusqu’aux épaules avec une frange qui couvre son front. À en juger par l’épais maquillage qui, au lieu de dissimuler ses rides, blanchit son visage asiatique, elle doit avoir une quarantaine d’années. Elle ressemble à une de ces poupées orientales qui accompagnent les jeunes filles à l’heure du thé. À cet instant, je me rappelle drôlement quand j’étais petit, mon père qui me disait de toujours prendre garde contre les femmes habillées en rouge. Alors, je réponds :
- À moins que vous n’ayez une meilleure idée…
- Déjà tu pourrais commencer par lever la tête vers le ciel.
J’obtempère.
- Et alors ?
- Que vois-tu ?
- Des lanternes célestes dans le ciel.
- Tu ne vois vraiment que ça ? Dis donc, tu feras bien d’être un peu plus imaginatif.
- Où voulez-vous en venir ?
- Pendant que tu t’amuses à acculer ce pauvre, petit crabe dans son trou, un autre que toi cherche à en sortir et à voler vers le ciel. Ce que tu vois là, au-dessus de toi, toute cette lumière qui vacille au vent, c’est la lutte de chacun contre les coups de blues dans la vie qui menacent d’éteindre cette lueur d’espoir, seulement protégée par une mince feuille de papier de riz. Que c’est magique ! On les voit bien, ces milliers de lanternes célestes, mais on ne saura jamais pour autant quels genres de vœux elles contiennent. De toute manière, le ciel est très beau ce soir.
- Oui, c’est vrai. Excusez-moi, mais il faut que j’y aille.
- Ça te dit qu’on fasse voler une lanterne chacun ? On ne se connaît pas, c’est vrai. Mais ce soir je suis toute seule. Et vu l’état d’ennui qui t’a amené à terroriser un pauvre crabe, je supposerais que toi aussi, tu es tout seul.
- D’accord, pourquoi pas…
- Au fait, moi c’est Deborah.
- Moi, c’est Am.
- Am ? Quel drôle de nom.
- Vous n’êtes pas la première à faire cette remarque. Am, c’est mon surnom. Si vous voyez à quel point c’est difficile de correctement prononcer mon prénom, ce ne sera plus drôle.
- Je vois. On y va, alors ?
Nous partons ensemble vers un endroit bien éclairé où les gens, avec leur briquet, sont en train d’allumer la mèche de leurs lanternes. On ne voit que les visages souriants éclairés par le feu doux qui s’intensifie, les yeux brillants à mesure que les lanternes se gonflent. Le vent est très fort ce soir. Les uns réussissent à faire voler leurs lanternes, qui grimpent en s’agitant violemment. Ceux-là, ils ont la tête levée vers le ciel, tournant au gré des lanternes qui s’en vont. Les autres essaient tant bien que mal d’allumer la mèche. Certains d’entre eux finissent par mettre le feu au papier de riz, qu’ils laissent tomber ensuite par terre en jurant quelques mots discrets.
Deborah part en courant vers un stand en bois où s’étalent des lanternes de toutes les couleurs. Elle revient portant une lanterne dans chaque main, une bleue et une rouge.
- Tiens, le bleu, c’est pour toi. Je préfère prendre le rouge.
Elle sort un briquet à elle. Ce doit être une fumeuse. Elle me le tend et fait un geste d’aller le premier. Tenant par le bord chacun de son côté, j’allume le briquet en portant le feu au-dessous de la mèche. Lorsque le feu a pris, la lanterne commence à rayonner de son bleu, un bleu mêlé du noir de la nuit au début, puis ce bleu s’allume peu à peu en même temps que la lanterne se gonfle, jusqu’à atteindre un bleu intense. C’est une couleur que je ne peux pas décrire. Je peux seulement la sentir rayonner sur moi, en même temps que cette chaleur qui caresse et gagne ma peau. Je suis envoûté par le calme d’esprit que m’apporte cette couleur. Mais il faut lâcher avant que la flamme se consume.
Alors, la lanterne s’envole. Je la regarde grimper le ciel avec assurance, malgré le vent. Elle est haute maintenant, très haute, plus haute encore. Je ne la vois plus en bleu. Elle n’est qu’un point lumineux. Puis, peu à peu, elle s’éteint. Je ne vois plus rien.
- J’espère que tu as fait de sacrés vœux, parce que celle-là, elle a bien grimpé les étoiles.
- Ah mince !
J’avais en effet oublié de faire des vœux. Il est minuit moins trois. Commencer le nouvel an sans avoir fait de vœux, ce sera continuer à vivre dans ce même état dépressif qui m’éloigne de la vie au jour le jour. Ce n’est pas pour dire que je suis superstitieux, mais tant qu’à faire, pourquoi pas aller jusqu’au bout des choses ? Alors, je demande à Deborah de me donner sa lanterne et après elle pourra s’en aller en chercher une autre pour elle-même. Je tiens vraiment à ce que cette année débute bien. Il y a longtemps que je ne suis plus heureux. Elle l’accepte.
Alors, les mêmes gestes se répètent, mais cette fois-ci, je n’oublie pas de faire des vœux avant de lâcher la lanterne rouge. Elle grimpe lentement, chancelant sur le côté, puis rejoignant la traînée des autres lanternes dans le ciel. Par moments j’ai le mauvais pressentiment qu’elle va tomber du ciel à tout moment. Mais elle continue à grimper, lentement. Le vent est encore très fort. Ma lanterne rouge commence à vaciller rapidement, penchée sur son côté, prête à s’éteindre. Elle ne va pas tenir, me dis-je. Minuit moins une.
Ce fut inattendu. Le vent se calme brusquement. Ma lanterne commence à tracer un parcours vertical. Elle monte à toute vitesse. Elle se libère de la flotte des autres lanternes. Elle grimpe encore.
- Dis donc, je ne m’attendais pas du tout à ça, s’exclama Deborah. Son début a été peu stable, mais elle se rachète par la suite. Regarde-moi ça !
En effet, la lanterne rouge avait traversé de bout en bout un nuage au-dessous d’un ciel étoilé. On ne voit plus qu’un point lumineux qui continue à grimper parmi les étoiles. Au bout d’un moment, elle semble se stationner, prenant sa place parmi les étoiles qu’on ne distingue plus des autres. Je ne vois plus celle qui porte mes vœux au ciel. Mais je me rassure : elle est là, elle sera toujours là, mon avenir.
Minuit.
Les feux d’artifice éclatèrent dans le ciel. Une floraison spectaculaire de toutes les couleurs. La luminosité intense de leurs éclats éclipse les lanternes des gens qui continuent à voler à leur gré dans le ciel. Le ciel est, en effet, très beau ce soir. Deborah se tourne vers moi, en me disant :
- Quelle effervescence ! Si seulement ça pouvait durer pour toujours.
- Je ne sais pas moi. Je trouve que ce serait un peu trop.
- N’importe quoi !
- Ravi d’avoir fait votre connaissance. Et merci bien pour la lanterne. Bonsoir.
Elle s’approche de moi, puis me prend dans ses bras. Je ne dis rien. Elle non plus. Puis, elle me lâche, me chuchotant à l’oreille :
- Ne sois pas si triste. La vie peut être si belle quand on le veut. Tu n’as pas à chercher à être heureux. Le bonheur viendra tout seul. Tu verras.
À peine eus-je le temps de réagir qu’elle était déjà partie dans la nuit.
–C.S.